Mots clés
Bétonnage,
destruction d'espaces naturels et de terres cultivables, prolifération
de centres commerciaux, atteinte à la bio-diversité,
risques d’inondation, espèces protégées,
réchauffement climatique, lutte contre le réchauffement
climatique

L'actualité
Le
projet AMAZON à Fournès (30)
Tous
les beaux discours de Madame la Présidente de l'Occitanie
sur l'artificialisation des sols et l'arrêt du développement
du PLU horizontal mais vertical vole en éclat si vous
vous appelez AMAZON
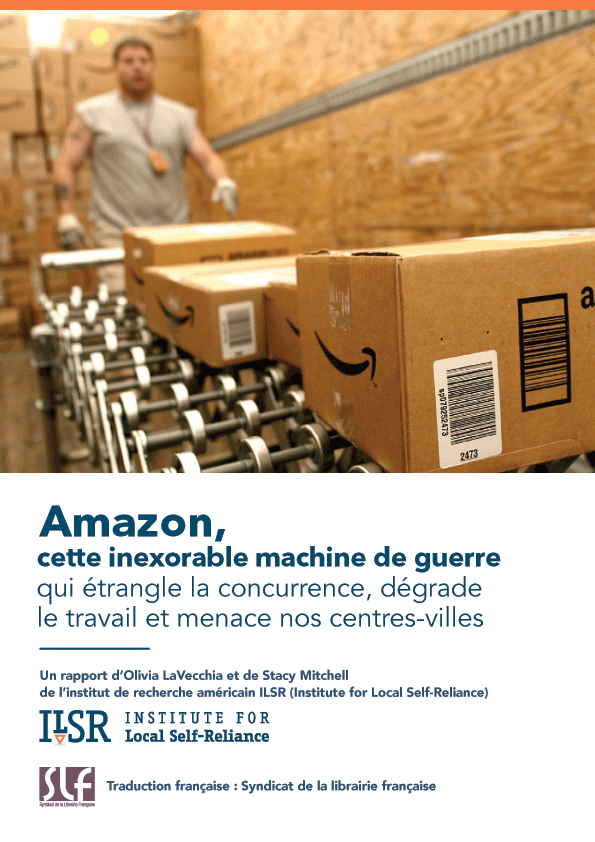
Accédez
à notre dossier...

Le développement
urbain constitue une menace pour le sol qui est considéré
comme une ressource non renouvelable
La
zone commerciale Porte Sud est un projet d'envergure de 7745
m² de surface de vente, mené par Foncière
de France, en lien étroit avec la ville d'Alès.
L'objectif est d'y installer 9 enseignes, dans la continuité
du Mas d'Hours où siègent notamment Cora, Renault
et Darty. "Les habitants vont faire leurs emplettes à
Nîmes et Montpellier. Ce n'est plus possible. Il faut
faire vivre ce territoire. Il y a 200 emplois à la clé",
insiste le promoteur Claude Dhombre, qui souhaite investir 10
millions d'€.
Sport, jeux, puériculture, maison, téléphonie,
vêtement, selon l'investisseur alésien, les futures
marques sont prêtes à poser leurs valises dans
la capitale cévenole. Mais leur identité reste
encore confidentielle.
Un délai
tenable ?
De fait, le dossier est loin de faire politiquement
l'unanimité. Claude Dhombre acquiert le terrain qui borde
le Gardon au début des années 2000 pour y construire
un espace commercial. Mais la préfecture s'y oppose.
Selon elle, la zone concernée pourrait être inondée
en cas de rupture de digue. En 2010, elle classe le terrain
en « aléa fort » dans le Plan de prévention
du risque inondation alésien.
Le promoteur refuse de voir son projet ambitieux
s'envoler. Il argue que la zone n'a jamais été
envahie par les eaux, même lors des plus fortes crues
de 1958 et 2002. "Vous croyez que je suis assez stupide
pour construire sur une surface inondable ?", fustige-t-il.
En septembre 2014, la ville obtient du tribunal administratif
de Nîmes la suspension de l'arrêté du préfet
imposant le PPRI. Quelques semaines plus tard, la Cour d'appel
de Lyon juge à son tour que les risques de rupture de
digue ne sont pas avérés. Devant ces décisions,
les détracteurs du maire Max Roustan, dont les conseillers
municipaux d'opposition Front de gauche, dénoncent un
acharnement mené sans concertation avec la population.
Aujourd'hui, c'est devant le Conseil d'Etat que
le dossier va être de nouveau expertisé, à
la demande du Ministère de l'Ecologie. Son avis - qui
n'a pas de valeur contraignante - devrait être rendu dans
les semaines à venir. Quel qu'il soit, Claude Dhombre
- qui est désormais titulaire d'un permis de construire
valide de la ville -, souhaite ensuite entamer des travaux le
mois prochain pour une ouverture dans un an. "Ce projet,
je le ferai. J'ai subi un harcèlement administratif et
c'est injuste", fustige-t-il.
Reste la partie parking appartenant à la
commune de St-Hilaire-de-Brethmas. Cette dernière a récemment
approuvé le projet, à la quasi unanimité
du conseil municipal. Il y a deux ans, le maire avait pourtant
envoyé un avis défavorable à la ville d'Alès.
"Il y a une logique avec l'existant. On a étudié
cet espace, situé entre la voie ferrée, la rocade
et la 2x2 voies. Il n'a pas d'intérêt écologique,
agricole ou urbain, autant l'utiliser. Pour nous, c'est aussi
un produit fiscal supplémentaire", assure le maire
Jean-Michel Perret. A deux conditions : que les procédures
judiciaires soient closes, et que le Plan local d'urbanisme
l'autorise. Il est actuellement en cours d'élaboration
et 2 ans d'instruction vont encore être nécessaires.
Inondations : le plan de prévention risque de
sauter

Les terrains du quartier de la prairie
sont au cœur des débats / Photo JEAN BERNARD
Les
terrains du quartier de la prairie sont au cœur
des débats.
Sourire sur toutes les lèvres - sauf sur celles
des représentants du préfet - hier matin
à Nîmes, à l?issue de l?audience
du tribunal administratif consacrée à
l?examen de 7 recours, dont ceux de la mairie d?Alès
et de l?association Alès Durable, visant à
obtenir l?annulation du plan de prévention des
risques inondation (PPRI) d'Alès, adopté
par le préfet du Gard le 9 novembre 2010.
Sourire de satisfaction et gros soulagement, notamment
de la part de Me Bernard Guibert, une pointure du barreau
de Marseille, qui plaidait dans 5 des 7 recours, accomplissant
de son propre aveu un travail "de titan" pour
faire capoter le PPRI, en essayant de s?engouffrer dans
la moindre faille de cet énorme dossier. Une
avalanche de moyens (document incomplet en page 25,
imprécisions et erreurs dans des graphiques,
incohérences entre la carte d?aléas et
le zonage, prescriptions trop imprécises du PPRI,
rupture du principe d?égalité entre les
terrains protégés...) qui ont pourtant
tous été longuement repoussés par
le rapporteur public, magistrat du tribunal dont l?analyse
et les conclusions sont dans la grande majorité
des cas suivies par ses pairs. Tous, sauf deux d?entre
eux, concernant le quartier de la Prairie, qui justifient,
à ses yeux, que le tribunal annule le PPRI.
Le premier pour "erreur manifeste d?appréciation
entachant le classement en zone rouge du secteur de
la Prairie" Même si le secteur est situé
dans le lit hydromorphogéologique majeur du Gardon,
il est protégé par une berge maçonnée
réalisée en 1958, d?une profondeur de
6,84 m de sa base au sommet, dont la stabilité
est attestée, a-t-il dit. La preuve : elle a
très bien résisté aux inondations
de 2002. D?autre part, a-t-il expliqué, une berge,
contrairement à une digue, "ne peut se rompre",
a dit le magistrat.
Un argument contesté par les représentants
du préfet, selon lesquels la berge viendrait
forcément à céder si l?eau devait
passer par-dessus. Deuxième argument : il y a
absence de distinction entre les zones F-U et les zones
F-Ud, qui classent les risques en fonction de leur gravité,
pour les parcelles des propriétaires.
"L?État a fait n?importe quoi en surdimensionnant
le principe de précaution pour se couvrir, au
détriment du développement économique",
estime Claude Dhombre, président d?Alès
Durable.
L'affaire est en délibéré. Le
tribunal n?a pas dit quand sa décision sera rendue.
© Midi Libre par PHILIPPE BERJAUD
|
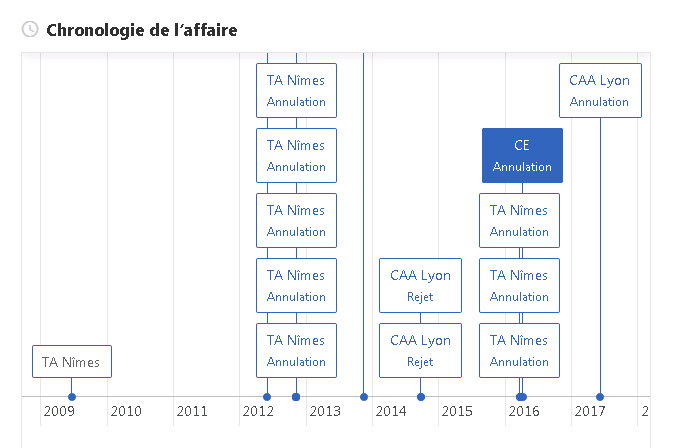
Le moteur de recherche juridique DOCTRINE
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 386000
Numéro NOR : CETATEXT000032374774 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2016-04-06;386000
?
Urbanisme et aménagement du territoire - Plans
d'aménagement et d'urbanisme.
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 386000 :
La commune d'Alès, l'association Alès
durable, M. D...C..., Mme B...A...et la SCI DEIC ont
demandé au tribunal administratif de Nîmes
d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté
du 9 novembre 2010 par lequel le préfet du Gard
a approuvé le plan de prévention des risques
d'inondation du Gardon d'Alès sur la commune
d'Alès, ainsi que les décisions des 4
février et 1er mars 2011 par lesquelles le préfet
du Gard a rejeté les recours gracieux de la commune
d'Alès et de Mme A...contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1100167 - 1100085 - 1100086 -
1101124 - 1101443 du 8 novembre 2012, le tribunal administratif
a annulé cet arrêté en tant qu'il
classe en zone exposée à un aléa
fort le secteur dit de la Prairie et en zone non urbanisée
exposée à un aléa fort au risque
la parcelle de MmeA..., ainsi que les décisions
des 4 février et 5 mars 2011.
Par un arrêt n°13LY20051 du 23 septembre
2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté
l'appel formé par le ministre de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie
contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire
et un mémoire en réplique, enregistrés
au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat
les 26 novembre 2014, 26 février 2015 et 23 février
2016, le ministre de l'écologie, du développement
durable et de l'énergie demande au Conseil d'Etat
:
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire
droit à son appel.
2° Sous le n°386001 :
La société Foncière de France
et la société Les Magnolias ont demandé
au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour
excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre
2010 par lequel le préfet du Gard a approuvé
le plan de prévention des risques d'inondation
du Gardon d'Alès sur la commune d'Alès.
Par un jugement n° 110008 du 8 novembre 2012, le
tribunal administratif a annulé cet arrêté
en tant qu'il classe en zone exposée à
un aléa fort au risque le terrain situé
1585 quai du mas d'Hours à Alès.
Par un arrêt n°13LY20050 du 23 septembre
2014, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté
l'appel formé par le ministre de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie
contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire
et un mémoire en réplique, enregistrés
au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat
les 26 novembre 2014, 26 février 2015 et 23 février
2016, le ministre de l'écologie, du développement
durable et de l'énergie demande au Conseil d'Etat
:
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire
droit à son appel.
....................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique
:
- le rapport de Mme Marie-Françoise Guilhemsans,
Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur
public ;
La parole ayant été donnée, avant
et après les conclusions, à la SCP Garreau,
Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune
d'Alès, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano,
avocat de Mme A...et à la SCP Potier de la Varde,
Buk Lament, avocat de la société Foncière
de France et de la société Les magnolias
;
1. Considérant que les pourvois du ministre
de l'écologie, du développement durable
et de l'énergie présentent à juger
les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre
pour statuer par une même décision ;
2. Considérant que le ministre de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie
demande l'annulation de deux arrêts par lesquels
la cour administrative de Lyon a confirmé l'annulation
de l'arrêté du préfet du Gard du
9 novembre 2010 approuvant le plan de prévention
des risques d'inondation du Gardon d'Alès sur
la commune d'Alès, en tant qu'il classe en zone
exposée à un aléa fort au risque
d'inondation, dès lors inconstructible, d'une
part la plus grande partie du secteur de La Prairie,
rive droite, et dans ce secteur, en zone non urbanisée
exposée à un aléa fort au risque,
la parcelle de MmeA..., et, d'autre part, rive gauche,
le terrain situé 1585 quai du mas d'Hours ; qu'il
ressort des énonciations de la cour et des pièces
du dossier soumis aux juges du fond que les terrains
litigieux sont situés dans le lit hydrogéomorphologique
majeur du Gardon, dont le caractère de zone inondable
est établi par les différentes études
produites, et sont protégés par une berge
maçonnée surmontée d'un quai ;
que le plan de prévention des risques d'inondation
classe en zone d'aléa fort les terrains situés
à une distance de moins de 100 mètres
de la digue, ainsi que ceux qui seraient, en l'absence
de digue et pour une crue comparable à la crue
de référence, recouverts par au moins
un mètre d'eau ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L.
562-1 du code de l'environnement : " I. L'Etat
élabore et met en application des plans de prévention
des risques naturels prévisibles tels que les
inondations, les mouvements de terrain, les avalanches,
les incendies de forêt, les séismes, les
éruptions volcaniques, les tempêtes ou
les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant
que de besoin : 1° De délimiter les zones
exposées aux risques, en tenant compte de la
nature et de l'intensité du risque encouru, d'y
interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement
ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale,
commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas
aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le
cas où des constructions, ouvrages, aménagements
ou exploitations agricoles, forestières, artisanales,
commerciales ou industrielles, pourraient y être
autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles
ils doivent être réalisés, utilisés
ou exploités ; / 2° De délimiter les
zones qui ne sont pas directement exposées aux
risques mais où des constructions, des ouvrages,
des aménagements ou des exploitations agricoles,
forestières, artisanales, commerciales ou industrielles
pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux
et y prévoir des mesures d'interdiction ou des
prescriptions telles que prévues au 1° ;
/ 3° De définir les mesures de prévention,
de protection et de sauvegarde qui doivent être
prises, dans les zones mentionnées au 1°
et au 2°, par les collectivités publiques
dans le cadre de leurs compétences, ainsi que
celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4°
De définir, dans les zones mentionnées
au 1° et au 2°, les mesures relatives à
l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation
des constructions, des ouvrages, des espaces mis en
culture ou plantés existants à la date
de l'approbation du plan qui doivent être prises
par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs...
" ; qu'aux termes de l'article R. 562-3 du même
code, " Le dossier de projet de plan comprend :
/ 1° Une note de présentation indiquant le
secteur géographique concerné, la nature
des phénomènes naturels pris en compte
et leurs conséquences possibles, compte tenu
de l'état des connaissances ; / 2° Un ou
plusieurs documents graphiques délimitant les
zones mentionnées aux 1° et 2° du II
de l'article L. 562 1 ; / 3° Un règlement
précisant, en tant que de besoin : / a) Les mesures
d'interdiction et les prescriptions applicables dans
chacune de ces zones en vertu des 1° et 2° du
II de l'article L. 562-1 ; / b) Les mesures de prévention,
de protection et de sauvegarde mentionnées au
3° du II de l'article L. 562-1 et les mesures relatives
à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation
des constructions, des ouvrages, des espaces mis en
culture ou plantés existant à la date
de l'approbation du plan, mentionnées au 4°
de ce même II. ".
Sur le regroupement dans la même zone réglementaire
des terrains considérés comme soumis à
un aléa fort, qu'ils soient ou non situés
derrière un ouvrage de protection :
4. Considérant qu'il résulte des dispositions
précitées que les plans de prévention
des risques naturels prévisibles ont pour objet
de définir des zones exposées à
des risques naturels à l'intérieur desquelles
s'appliquent les interdictions, prescriptions et mesures
de prévention, protection et sauvegarde qu'ils
définissent ; que ces dispositions ne font pas
obstacle à ce qu'une même zone regroupe
l'ensemble des secteurs soumis aux mêmes interdictions,
prescriptions et mesures, sans qu'il soit nécessaire
que les motifs différents qui ont pu conduire
à les soumettre à des règles identiques
soient identifiables par un zonage différencié
; que, dès lors, le ministre de l'écologie
du développement durable et de l'énergie
est fondé à soutenir qu'en jugeant, par
l'arrêt n°13LY20051, que la circonstance que
la zone FU, zone urbanisée inondable par un aléa
de référence fort, et la zone FUd, zone
urbanisée située en contrebas d'une digue,
seraient soumises aux mêmes prescriptions ne pouvait
dispenser les auteurs du plan de prévention de
les distinguer dans le zonage réglementaire,
la cour administrative d'appel de Lyon a commis une
erreur de droit ;
Sur le classement en zone d'aléa fort des terrains
litigieux :
5. Considérant qu'il résulte des dispositions
du code de l'environnement citées au point 3
ci-dessus que le classement de terrains par un plan
de prévention des risques d'inondation en application
du 1° du II de l'article L. 561-2 du code a pour
objet de déterminer, en fonction de la nature
et de l'intensité du risque auquel ces terrains
sont exposés, les interdictions et prescriptions
nécessaires à titre préventif,
notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies
humaines ; que lorsque les terrains sont situés
derrière un ouvrage de protection, il appartient
à l'autorité compétente de prendre
en compte non seulement la protection qu'un tel ouvrage
est susceptible d'apporter, eu égard notamment
à ses caractéristiques et aux garanties
données quant à son entretien, mais aussi
le risque spécifique que la présence même
de l'ouvrage est susceptible de créer, en cas
de sinistre d'une ampleur supérieure à
celle pour laquelle il a été dimensionné
ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance
de tels accidents n'est pas dénuée de
toute probabilité ; qu'ainsi, en jugeant que
le risque d'inondation de terrains situés derrière
un ouvrage de protection ne pouvait valablement être
pris en compte que s'il était établi qu'eu
égard à son état, l'ouvrage se
trouvait exposé à un risque de rupture
ou de surverse, la cour administrative d'appel de Lyon
a commis une erreur de droit ;
Sur les conclusions présentées au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
:
6. Considérant que les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle
à ce que soient mises à la charge de l'Etat,
qui n'est pas, dans la présente instance, la
partie perdante, les sommes demandées à
ce titre ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les arrêts n° 13LY20050 et
n° 13LY20051 du 23 septembre 2014 de la cour administrative
d'appel de Lyon sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à
la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées
par la commune d'Alès, Mme A...et les sociétés
Foncière de France et les Magnolias au titre
des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera
notifiée à la commune d'Alès, à
MmeA..., aux sociétés " Foncière
de France " et " Les Magnolias " et à
la ministre de l'environnement, de l'énergie
et de la mer, chargée des relations internationales
sur le climat.
Publications :
Proposition de citation: CE, 06 avril 2016, n° 386000
|
Les politiques d'aménagement du territoire,
en particulier dans les zones périurbaines, devraient
tenir compte, lors de l'élaboration des documents d'urbanisme,
de l'aptitude des sols à remplir certaines fonctions
économiques ou écologiques.
Pour 23 pays de l'Union Européenne, 48 % des terres qui
ont été artificialisées de 1990 à
2000, étaient des terres arables ou occupées par
des cultures permanentes. Au niveau français, l'accroissement
de l'artificialisation, de 1990 à 2000 (Corine Land Cover),
qui s'élève
à environ 4,8 %, est surtout du à celle des zones
industrielles et commerciales.
Selon Eurostat, les sols artificialisés
recouvrent les sols bâtis et les sols revêtus et
stabilisés (routes, voies ferrées, parkings, chemins...).
Le ministère de l'Agriculture en France retient une définition
plus large, qui recouvre également d'autres " sols
artificialisés ", comme les chantiers, les terrains
vagues, et les espaces verts artificiels. L'artificialisation
correspond à un changement d'utilisation, laquelle n'est
pas nécessairement irréversible.
L'artificialisation, c'est un changement complet
et souvent irréversible de l'usage des sols. La France,
très touchée par ce phénomène, fait
face à deux enjeux existentiels : la perte de capacité
agricole et la perte de biodiversité.
La disparition des champs entraîne la diminution des capacités
du pays à subvenir à ses besoins alimentaires.
C'est une perte d'autonomie considérable et paradoxale
car qui dit " augmentation de population " dit "
augmentation des besoins alimentaires ".
Comment suivre l'artificialisation des sols ?
Il existe, en France, deux outils d'observation
de l'occupation du sol permettant de mesurer l'évolution
des surfaces artificialisées : l'outil européen
Corine Land Cover (créé en 1990) utilisé
par le ministère de l'Écologie et Teruti-Lucas
(créé en 1993) utilisé par le ministère
de l'Agriculture. Ces deux systèmes ne mesurent pas l'usage
des sols de la même manière. Corine Land Cover
se sert d'images satellite sur l'ensemble du territoire alors
que Teruti-Lucas, plus précis, procède par observations
autour de points de repère quadrillant le territoire.
Selon Corine Land Cover, entre 1990 et 2006, la part des surfaces
artificialisées sur le territoire métropolitain
passe de 4,6 % à 5,1 %, ce qui correspond à une
perte de 281 354 ha en 16 ans dont 122 949 ha sur la période
2000-2006. Les surfaces artificialisées sont plus élevées
selon Teruti-Lucas. Elles représentent 7 % de la surface
métropolitaine en 1993 et 9,4 % en 2008.
D'après le ministère de l'Environnement, les espaces
agricoles et naturels perdent actuellement 236 hectares par
jour, ce qui correspond à la superficie d'un département
français moyen (610 000 hectares) tous les sept ans.
Résultat en deçà de la réalité,
puisque le ministère de l'Environnement utilise Corine
Land Cover, qui ne considère pas les zones industrielles
et commerciales comme du tissu urbain.
À titre de comparaison, l'avancée moyenne des
sols artificialisés sur la période 1992-2003 mesurée
par l'enquête Teruti était déjà de
61 000 hectares par an, soit un département tous les
dix ans. L'artificialisation s'accélère. La France
a ainsi perdu 7 million d'hectares de terres agricoles en 50
ans et 900 000 hectares de prairies entre 1992 et 2003 (7 %
de leur superficie).
La réalité est toutefois plus inquiétante
que ne le laissent paraître les chiffres car l'artificialisation
est très dispersée. L'espace urbain global est
donc bien plus important, c'est le mitage.
Les sols boisés ne sont pas non plus épargnés.
Ils couvraient 17 millions d'hectares en 2009, soit près
de 31 % du territoire métropolitain (14,9 millions d'hectares
de forêts et 2,1 millions d'hectares d'autres sols boisés).
Selon l'étude, la forêt française ne perd
pas de terrain mais n'en gagne plus : la surface des forêts
(y compris les peupleraies) se stabilise, mais les formations
boisées non forestières, bosquets et haies, se
réduisent certes faiblement mais significativement.
Un constat alarmant que partage, en France, la Fédération
nationale des SAFER (Sociétés d'Aménagement
foncier et d'établissement rural). Dans un volet de son
étude annuelle sur le marché foncier rural, elle
constate une progression constante de l'artificialisation des
sols de l'hexagone. L'urbanisation est passée de 54 000
ha par an dans les années 80, à 61 000 ha dans
les années 90 et a atteint 74 000 ha par an entre 2006
et 2008.
Des
solutions concrètes
Une étude française, parue dans
la revue Nature Climate Change et réalisée par
l'économiste Stéphane Hallegatte et le spécialiste
du climat Vincent Viguié, du Cired (Centre international
de recherche sur l'environnement et le développement)
a modélisé un urbanisme plus vert de la région
parisienne. L'enjeu est de taille, comme l'explique M. Hallegatte
cité par l'AFP, " en l'absence d'action spécifique,
l'étalement urbain va se prolonger et on aura en 2030
encore plus de zones à basse densité de population
qui dépendent de l'automobile" . Mais la solution
est relativement simple selon lui. Il suffirait " d'interdire
toute nouvelle construction au-delà des limites de l'agglomération"
. Pour éviter une pénurie de logement, tout en
préservant l'environnement, les chercheurs proposent
la mise en place simultanée de trois mesures :
" Interdire les constructions au-delà des limites
actuelles de l'agglomération parisienne pour créer
une " ceinture verte "
" Développer les transports en commun avec un tarif
unique de 14 euros par mois
" Interdire les constructions en zone inondable, des inondations
plus fréquentes étant attendues avec le réchauffement.
Les solutions proposées devaient garantir
quatre critères : permettre un accès au logement,
réduire les gaz à effet de serre, réduire
les risques naturels et lutter contre l'étalement urbain.
L'application simultanée des trois mesures est capitale
car " chacune des politiques compense les problèmes
créés par les deux autres ", précise
Vincent Viguié. L'étude suggère un besoin
de cohérence globale des décisions en intégrant
l'environnement dans les politiques traditionnelles, de transport
et de logement par exemple. Avec ces travaux, " on veut
montrer que faire de l'environnement n'est pas forcément
contradictoire avec l'accès au logement ou la qualité
de vie ", conclut l'économiste Stéphane Hallegatte.
Artificialisation
— Wikipédia
artificialisation
des sols définition
artificialisation
des sols conséquences
artificialisation
des sols dans le monde
artificialisation
définition simple
artificialisation
synonyme
artificialisation
du territoire français
artificialisation
des terres agricoles définition
artificialisation
definition géographique
Association
Causses-Cévennes d'action citoyenne
Avenue du Devois, Le Devois, Saint Sauveur Camprieu, 30750, tel
0467826111.
Site internet : http://www.accac.com, Email: adhca@live.fr
|
|